Rumeurs des villes
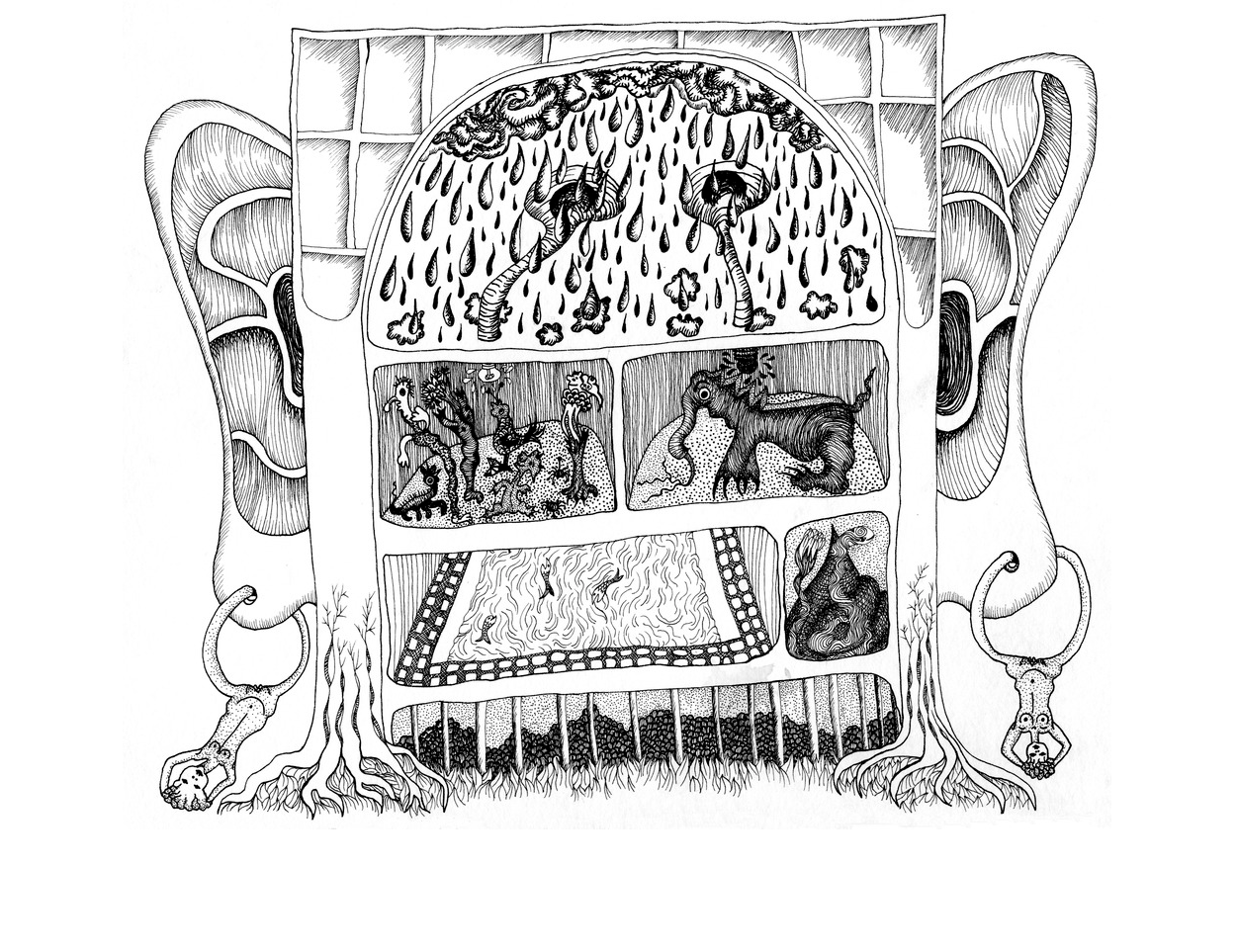
Liza Maignan est lauréate de la seconde édition de la Bourse d'écriture TextWork.
— Je vais sur le « plateau », c’est encore loin ?
— Vous êtes déjà sur le « plateau ». Il est là. Il est partout.
Alors comment se retrouve-t-on sur le plateau de Millevaches ? Je ne connaissais pas vraiment l’histoire du « plateau », de la région du Limousin, et encore moins du département de la Corrèze. Cette zone rurale et centrale française était pour moi, comme pour de nombreux enfants ayant grandi en régions, un trou perdu. Ou la diagonale du vide, comme on dit aujourd’hui. En trébuchant dans la trentaine en période de post-pandémie mondiale, j’ai commencé à entendre autour de moi des désirs de campagne, de « se mettre au vert ». Mais le risque, en ruralité, c’est qu’on se caille en hiver et qu’on peut vite se sentir seul·es. Et ça, ça a un prix. Alors se mettre au vert est devenu un débat classique autour d’une pinte à cinq euros. Et toi, tu serais prêt·e à quitter Paris ?
J’ai découvert la Corrèze, hors du contexte de l’art (mon domaine professionnel), grâce à une amitié de longue date. Régulièrement, je partais en vacances dans la région et, par la suite, j’y ai découvert plusieurs lieux indépendants et autogérés, comme Treignac Projet et Cocotte, à Treignac, l’Amicale mille feux, à Lacelle, Fossile Futur, à Meymac, et j’ai ainsi rencontré certaines personnes qui ont fondé, expérimenté et habité ces espaces et ce territoire qui les accueillent. Chloé Munich, Vincent Lalanne, Olga Boudin, Tatiana Pozzo di Borgo, Laura El-Beze, Julien Salban-Crema, Sam Basu, Maxime Bichon, Matthieu Palud et Louise Sartor, Charlotte Houette, Avril Tison, Simon Dubedat, Sarah Melen, Pacôme Ricciardi, Baptiste Perotin m’ont généreusement transmis leurs récits, autour d’un repas, d’une balade, d’un verre d’eau au soleil ou d’une tisane au coin du feu.1 Je n’ai jamais vouvoyé ces personnes et, pour certain·es, je n’ai jamais entendu leur nom de famille avant de le leur demander et de les faire exister comme sujets de mes recherches, basculant dans un champ formel, au-delà de nos rencontres spontanées. Alors je les tutoierai, comme je l’ai fait depuis le début, et j’emploierai leurs prénoms pour les évoquer, comme au quotidien. Car hors de l’espace social de l’art contemporain, nos noms de familles ne sont pas des cartes de visite qui se googlisent. Et, de mon côté, je ne suis ni journaliste, ni sociologue, ni historienne, ni économiste, ni artiste. Je ne sais pas réellement ce que je suis, mais je sais ce que je fais.
Quitter Paris
La fille de mes amix est si fière de dire qu’elle est née à Paris. Lorsqu’elle est née, j’ai gardé leur chienne. Pendant plusieurs jours, je me suis baladée fièrement dans les rues du Marais avec cette chienne ébouriffée qui tirait au bout de sa laisse. Paris, c’est crade. Une chienne dans Paris, c’est crade. Une désillusion s’est installée à mesure que le coussin blanc dans son panier se teintait de gris. Cela ne m’a pas étonnée lorsqu’iels m’ont annoncé quelques années plus tard, qu’iels avaient décidé de quitter Paris. Avant de partir, iels y ont listé dans un tableau Excel toutes les régions de France et les paramètres à prendre en compte pour choisir le territoire le plus adapté à leurs besoins. Un réel outil qui leur a permis de dessiner les contours du quotidien politique dans lequel iels souhaitaient s’ancrer.
Quelques années plus tard, Olga et Julien m’expliquent à leur tour comment iels et d’autres membres de l’Amicale mille feux sont arrivé·es sur le plateau de Millevaches. En 2015, alors qu’iels étaient étudiant·es à l’École des beaux-arts de Paris, iels avaient eu vent des liens que les étudiant·es du séminaire de Jean-François Chevrier avaient développés et entretenus avec le plateau de Millevaches, notamment avec l’association Peuple et Culture Corrèze2, basée à Tulle. En 2009, le groupe RADO3 s'est ainsi constitué autour de huit artistes : Fanny Béguery, Madeleine Bernardin, Florian Fouché, Adrien Malcor, Anaïs Masson, Maxence Rifflet, Claire Tenu, Antoine Yoseph. Entre 2011 et 2014, RADO a développé un projet au long court, intitulé Ce qui ne se voit pas, suivi d’une exposition itinérante portant le même nom en 2014 à l’église Saint-Pierre, à Tulle, et au Centre international d’art et du paysage, à Vassivière. Iels ont travaillé avec des habitant·es afin de rendre visibles les activités invisibles, par le biais de documentations photographiques, d’installations ou encore la création de documents éditoriaux tels que le Rapport sur l’état de nos forêts et leurs devenirs possibles. Pour cette exposition, iels ont prêté leurs gestes, mobilisé leurs regards, mis au service leurs outils plastiques auprès des personnes locales qui portent des luttes, perpétuent des savoir-faire, relatent des histoires locales oubliées ou qui exercent des pratiques dans le paysage social, pour ainsi relire le « pays de Tulle » et l’usage de ce territoire par les habitant·es.
La découverte de ces activités artistiques et de ce territoire a permis à Olga et Julien d’envisager la possibilité de s’installer sur le plateau de Millevaches, et plus précisément dans le village de Lacelle, afin de continuer à travailler, à faire de l’art (ou non), à réfléchir à comment vivre autrement. Car ce qui semble lier chaque personne de l’Amicale mille feux ou de Fossile Futur (installé dans une ville voisine quelques années plus tard), c’est un désir de quitter quelque chose qui ne leur convient pas, de combler un besoin d’émancipation et d’autonomie. Ce quelque chose serait un trop-plein. Un trop-plein de galères, de conditions économiques instables, d’insertions institutionnelles nécessaires à l'existence d’une pratique. Une envie de faire le vide pour reconstruire leurs espaces, reconfigurer leurs rythmes, redéfinir leurs modes de vie, de travail, indissociables de leurs postures politiques. Des présences et des activités militantes, politiques, philosophiques, qui se sont multipliées sur le plateau de Millevaches, notamment dans le village de Tarnac, ont aussi confirmé ce désir d’ancrage territorial, historiquement infusé et porté par d’autres luttes nationales ou internationales, comme celle du Larzac dans les années 1970 ou celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes montée dans les années 2010 par les opposants au projet d’aéroport du Grand Ouest.




Chemin faisant, de mille vaches en mille feuilles
C’est l’été et la Grèce est en train de brûler. Je suis dans le camion aménagé de ma mère, nous roulons dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. Par la fenêtre, je regarde les arbres défiler, la puissance du vert des feuilles calme mes crises d’éco-anxiété. En chemin, je reçois un sms de mon ami Franck : il sera à Treignac Projet ce soir pour un vernissage. Nous décidons de bifurquer légèrement de notre itinéraire et de le rejoindre dans ce lieu, implanté dans le village de Treignac. Je déambule avec ma mère à mes côtés dans cette ancienne usine de filature, habitée depuis bientôt dix-sept ans par Sam, Liz et les communautés temporaires ou les solitaires qui s’y installent en résidence : principalement des cuvées d’été. J'identifie assez rapidement Sam, avec ses cheveux attachés en chignon. Je ne connais pas le visage de Liz. Je ne leur ai pas parlé ce soir-là. Sam et Liz sont les capitaines de ce navire de briques et de béton, sexy car post-indus à fond. Je ne comprends pas bien les modalités de ce lieu labyrinthique, bien que je sois familière des grands espaces vêtus de sol gris et de murs blancs. Je comprends qu'il y a des lieux dédiés : les salles d’expositions, la cuisine, le club, la salle d’enregistrement. Je ne sais pas s’il y a une partie réellement « privée », pour la vie quotidienne de Sam et Liz, ou si chaque pièce est publique. Je reconnais un peu le type d’usage de ces grands bâtiments dans lesquels il fait froid, été comme hiver, dans lesquels il y a continuellement des travaux à faire pour ne pas que cette architecture, aussi imposante que fragile, ne lâche.
Pendant la soirée, ma mère me présente Matthieu. Matthieu me présente Louise. Le lendemain, nous les retrouvons. Cette fois, on remonte plus haut dans le village, en le traversant à pied par l’une des rues principales. En arrivant chez Louise et Matthieu, on découvre leur espace nommé Cocotte, un espace au rez-de-chaussée, que j’imagine être une ancienne boutique, constitué de deux grandes vitrines qui font l’angle et se rejoignent à la porte d’entrée. Cocotte, c’est une pièce lumineuse, elle aussi avec des murs blancs, qui fait la belle part aux autres. À l’étage, l’espace de vie de Louise et Matthieu. Cette maison appartient à Sam et Liz, iels la mettent à disposition à titre gracieux. Elle est un appendice, une annexe autonome de Treignac Projet, l’ancienne usine en contrebas du village.
Qu’est-ce qu’on peut faire quand on est amix ?
À l’heure où j'écris, Cocotte a quitté Treignac. Cocotte n’a plus d’adresse et ne sait pas encore sous quelle forme elle continuera à exister. Cocotte a pris ses quartiers pendant presque trois ans dans le village de Treignac. Ces bâtisses adelphes sont comme de grandes maisons de vacances coopératives. Elles ne souhaitent pas vivre dans une maîtrise du temps comme on l'attend d’un service public (de la culture). La mise à disposition de leur temps est sans attente, sans rendement, échappant à une organisation calendaire attendue, défaite de toute autorité financière et d’une recherche de reconnaissance individuelle. Elles accueillent des amix, des amix d’amix, rencontré·es par-ci, par-là. Pour dormir, pour travailler.
Chez Cocotte, les invitations me sont présentées comme subjectives, sans logique ni stratégie. Si ce n’est l’envie de faire entendre des noms4 qui ne sont pas déjà sur toutes les lèvres institutionnelles, comme un jeu de sept familles dont on n’aurait pas encore pioché toutes les cartes. Pour certain·es, il n’y a même pas d’enjeu à exposer avec Cocotte autre que le plaisir de voir leur travail exister dans un contexte et une temporalité dédié·es. À chaque invitation, la situation change. Même si on partage toujours la cuisine et la salle de bains. Quand il n’y a pas d’argent, les relations sont de nature différente. Quand il n’y a pas d’argent, on fait les choses autrement. « L’important, c’est de savoir ce que tu as à offrir », me dit Louise. L’échange se base sur la rencontre, non sur un aspect pécuniaire. Ces lieux peuvent échapper au diktat de la rémunération, car la valeur ajoutée, la ressource, c’est elleux, et sans profit.
Pour Maxime, un ami de Treignac Projet, ce lieu est déjà une œuvre en soi. Car il implique toutes les conditions nécessaires pour produire de la convivialité réciproque : « Si tu viens à Treignac Projet, tu donnes à Treignac Projet. » C’est une générosité à double sens, un espace abstrait qui présage des amitiés5 avant qu’elles n’existent, dans un recommencement sans fin, puisqu’à Treignac Projet il n’y a pas de projet, pas de modalité de fonctionnement prédéfinie, pas de but à atteindre. Treignac Projet se traverse comme un palais de la mémoire détraqué : on oublie notre but à chaque porte, on bascule de seuil en seuil.
Je me demande alors si ce n’est finalement pas une forme inconsciente de capitalisation de l'amitié, impliquant une forme d’intérêt mutuel, qui n’est pas à envisager négativement. Car si je suis amix avec toi, c’est que pour différentes raisons (intellectuelle, émotionnelle, relationnelle) j’ai de l’intérêt pour toi. Et j’entends déjà certain·es d’entre vous crier à une forme « d’entre-soi ». C’est de l’entre-soi, oui. Mais un entre-soi à envisager comme la constitution de relations plus larges, hors d’un système familial normatif, uniquement amical ou purement professionnel ; un espace nécessaire pour énoncer ensemble une volonté d’exister hors de l’institution, de l’argent, de toute forme d’autorité et permettre la création d’autres types de relations qui auraient leurs propres rythmes, leurs propres systèmes. C’est aussi pour cette raison que le temps s’allonge à Treignac, à Lacelle ou à Meymac, car la temporalité sur ces territoires permet différentes possibilités de rencontres. Soit un ajustement du temps relationnel qui permettrait de vivre sous le régime fantasmé de l’idiorrythmie6, prenant en considération à la fois les rythmes solitaires et les rythmes communautaires. Ces contre-espaces, existant hors d’un temps ou d’un espace « dominé »7 induit par l’organisation étatique et les rythmes capitalistes de nos villes, ouvrent alors la possibilité d’une réorganisation de la vie sociale, notamment par le biais de la création artistique.
Mais alors, que risque-t-on à quitter l'art ? Aucun risque.
Je suis installée au soleil dans le jardin de l’Amicale mille feux avec Sam, il a bu trop de café. Il s’est déplacé pour venir me raconter l’histoire de Treignac Projet, avec son accent anglais que je ne comprends pas toujours. Je lui demande souvent de répéter, il cherche ses mots, on fait du franglais, on rigole. Le soleil tape sur la table en plastique blanc, sur laquelle il y a encore des flaques de la pluie de la veille. Sam considère que la condition pour trouver ce paradis, c’est d’accepter la perte, l’impossibilité d’être ailleurs. Sam est sensible aux différentes vies dans une vie. Selon lui, ne pas être quelque chose est une forme en soi. Pour une majorité d’entre nous, il est impossible d’être artiste-auteur·ice à plein temps si tu n’as pas une famille qui t’aide ou un travail complémentaire (tu n’es donc déjà plus artiste-auteur·ice à plein temps). Même si ta classe sociale ne change pas ta capacité à être artiste, elle change tes possibilités à l’être pleinement. Alors tu dois toujours te demander, qu’est-ce que tu perds / qu’est-ce que tu gagnes ? Peu importe. En gagnant, tu seras toujours perdant·e. Alors acceptons de perdre une vie pour une autre. La mise en retrait n’est pas une sous-catégorie de choix, nous ne basculons pas dans le régime du moins (-). La valeur de notre vie n’est pas en déficit, mais elle s’équilibre avec le trop-plein, permet de replacer le curseur entre le burn-out et le bore-out.
Sam dit que c’est comme rester dans une phase de deuil, elle te pousse vers l’avenir. Elle te permet d’être encore lié·e au passé. Sentir une fin, et trouver des possibilités de continuer quand même. Elle permet de rester en tension, de se souvenir de ce qu’on a quitté et de rester dans la maîtrise de l’avenir. Pour préserver ce qu’il s’est passé. Sam sait que lorsque le bâtiment sera terminé, le projet sera terminé. Mais il ne souhaite pas que le projet se termine, il préfère maintenir cette relation avec ce qui n’est pas terminé, comme avec l’histoire industrielle du bâtiment. Le mouvement de recul, de décentralisations géographique et sociale n’opère pas un changement dans les formes, mais permet une dispersion vers une restructuration des modes d’existence de l’art, de créer des diagonales, redistribuer l’attention, les ressources. Nous sommes d’accord pour dire que la ruralité n’apporte pas une nouvelle forme d’art, mais permet un changement dans les attitudes, envers les objets, les processus, la manière d’expliquer et d’accueillir l’autre. La question de l’art reste présente, mais c’est la relation à l’art qui change, les possibilités d’existence de l’objet changent. Si l’esthétique relationnelle n’a pas réussi à trouver sa place, surjouée dans les institutions de l’art, elle reste à l’endroit où elle prend sa source : le quotidien. On se demande alors : qui a l’autorité de dire et de faire de l’art ?
Le quotidien ne se regarde pas
Sam me dit qu’ici iels échappent à la croyance que l’art va sauver le monde, mais qu’iels essaient de se focaliser sur les relations, car l’art permet de croiser les disciplines et donc les gens. Mais cela est impossible à esthétiser, ces rencontres qui se passent autour d’un objet A, ces choses-là ne sont pas quantitatives. C’est cette relation qu’on essaie toustes de lier, de comprendre. C’est cette relation qu’on nomme public. Ici, il y a quelques locaux curieux, certes, mais souvent avisé·es car venant d’un milieu culturel proche, il y a des potes de Paris ou d’ailleurs, et le visiteur numérique qui like sans relâche. J’ai le sentiment que ces lieux sont des espaces de générosités qui ne cherchent pas à répondre à des manières attendues d’exister, et face auxquels certain·es projettent une forme de pureté, cherchant à savoir à tout prix s’ils « fonctionnent » ou non. Ce n’est pas la question. Ces initiatives existent. Et les personnes qui en prennent soin invitent, accueillent, inventent, exposent, programment, accompagnent, préparent de bons repas pour elleux et les gens du village, iels documentent (un peu). L’avantage aussi d’être à la campagne, d’être en marge, c’est de ne pas être déçu·e d’un manque de public, puisqu’en soi il n’y a pas vraiment de public attendu. Chaque spectateur·ice supplémentaire, c’est du bonus. S'il n’y a pas d’attente, il n’y a pas de déception. Le moment existe, comme on existe à travers lui. Le quotidien ne se regarde pas, il se vit. Comme la réciprocité d’une émotion, il ne s’archive pas. Vivre dans un village de 130 habitant·es, c’est une question d’entente. Il faut s’apprivoiser les un·es les autres. Il y a toujours des histoires, des copinages, les écarts politiques et générationnels qui se font ressentir. Les nouvelles et nouveaux arrivant·es attisent toujours la curiosité et les ragots. Une autre question revient souvent : comment faire exister ces lieux et les rendre accueillants, sans se sentir comme des parasites ou des semeur·euses de troubles ? Julien m’explique qu’iels ont réalisé que les habitant·es du village de Lacelle ne se sentaient pas invité·es lorsqu’iels collaient des affiches dans le village pour communiquer sur des événements de l’Amicale mille feux. En effet, c’est très facile lorsqu’on est extérieur·e à un espace, un groupe (aussi ouvert soit-il) de ne pas se sentir légitime à aller à une manifestation artistique, un événement musical, un atelier militant. Lorsqu’on se sent loin de ce domaine et de ces préoccupations. On a toujours peur de ne rien comprendre, de se sentir bête, de ne pas être inclus·es dans les discussions. Il faut trouver un équilibre dans la communication, dans la transmission de l’intention. Les habitant·es de Lacelle semblaient penser que la présence des affiches dans le village était une manière à l’Amicale de dire : « Cela existe. » Maintenant, les invitations sont déposées, une à une, dans les boîtes aux lettres des habitant·es, pour qu’iels entendent l’intention : Vous êtes les bienvenu·es. Dans ce lot d'implications et de cohabitation collectives, il y a toujours l’aspect négatif de la promiscuité et de la confrontation avec des personnalités extérieures qui n'apprécient guère les modes de vie des un·es et des autres. Alors il leur faut dealer avec tous ces paramètres.
Écouter à travers les murs d’hier
Les habitant·es de la maison nommée Fossile Futur me rapportent avec émotion qu’un après-midi un couple de personnes âgées, en passant le pas de la porte toujours ouverte, leur avait raconté l’histoire de leur rencontre dans cette maison, qui était à l’époque la banque du village. Lui y était employé et elle, serveuse dans le restaurant d’en face. Leur histoire s’est écrite depuis les fenêtres de chacune des bâtisses qui se regardaient, sur le bord de la route qui les séparait. Une autre histoire de murs : Sam me raconte que lors des premières ouvertures publiques, des personnes qui avaient travaillé dans l'usine venaient redécouvrir le bâtiment et raconter leurs récits d’ouvrier·ères. Les bâtiments ont des histoires. En produisant d’autres gestes dans ce bâtiment, une ancienne usine de filature, se retirent ceux des ouvriers devenus obsolètes à la fermeture de l’usine. On écrit de nouvelles vies pour ces bâtiments et ces récits seront un jour les récits passés de ces lieux, qui constitueront le terreau pour d’autres expériences, et leurs souvenirs.
Dans la maison Fossile Futur (dans un premier temps mise à disposition à titre gratuit par la propriétaire en échange d’en prendre soin), un collectif éponyme à géométrie variable habite depuis bientôt deux ans. Fondé à l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse, celui-ci est constitué d’une dizaine de membres, deux d’entre elleux vivent ici à l’année, alors que pour d’autres la maison est un point de chute régulier, un espace de travail temporaire, un projet à long terme, un lieux de retrait, de repos. À l’entrée, un petit dépliant et des étendards sérigraphiés, conçus par Simon Dubedat et Léa Chaumel, énoncent quelques recommandations pour respecter le fonctionnement de la maison et la cohabitation avec ses habitant·es quotidien·nes et temporaires.
Simon est designer. Depuis quelques années, il développe des outils afin de faciliter la communication en groupe, des dispositifs de parole coorganisés dans un respect mutuel. Il m’explique qu’il avait commencé à réfléchir à toute une série d'objets, de contenus et de dispositifs en open source découverts en arpentant divers lieux collectifs. Lever un doigt, un second ou un troisième pour définir sa place dans l’ordre de prise de parole, voter de manière non binaire pour rendre des avis plus diffus et nuancés, etc. Simon développe actuellement un prototype de jeu de société qui regroupe tous ces dispositifs pour permettre à des collectifs, ou tout autre type d’institutions curieuses, de comprendre les rapports de domination qui peuvent s’installer lors de réunions ou de débats. Ces méthodes de parole collective se sont mises en place dans le quotidien de la maison, où elles continuent d’être expérimentées, afin que chaque habitant·e trouve son propre rythme au sein du groupe, son équilibre et sa participation. En somme, des dispositifs ouverts grâce auxquels des personnes qui n’arrivent pas à trouver leur place dans des espaces de travail collaboratif puissent y parvenir plus aisément. J’existe en parlant de vous. J’existe avec et à travers vous.
Faire fleur8, sortir de terre pour faire trébucher
C’est encore l’été et, cette année-là, c’est la côte atlantique qui brûle. Olga et Tatiana m'accueillent dans leur maison, l’ancienne poste du village de Lacelle, dans laquelle il y a des arcs-en-ciel qui se reflètent sur les murs et où il faut faire attention aux trous dans le plancher. Cette maison se trouve à seulement quelques mètres d’une grande bâtisse qui nous accueille frontalement lorsqu’on descend du train à la petite gare de Lacelle. Cette grande bâtisse est divisée en deux parties : une première aile est accessible par une double porte en métal jaune qu’on repère de loin, la devanture de la seconde est plus discrète, une porte en bois vitrée et, au centre, une porte-fenêtre condamnée par un banc en bois, et quelques affiches – sur l’une d’elles on peut lire : « En grève jusqu’à la retraite » avec un petit chien rose malicieux qui tient dans sa bouche une affichette « Borne Out »9. Les autres affiches sont trop floues dans mes souvenirs. En levant les yeux, quatre lettres sont dessinées : F-E-U-X et, juste au-dessus, gravé sur un morceau de bois, le nom de la maison : Amicale mille feux. Dans l’aile gauche de ce bâtiment, il y a deux appartements, dans lesquels vivent Julien et Laura, que je n’avais pas revu·es depuis la fin de nos études.
Julien et Olga, héritier·ères d’une pensée communarde partagée, évoquent leurs différentes étapes amicales avant de s'installer à Lacelle : une première année de lutte contre la loi El Khomri en 2016, une occupation de trois jours de leur école (une courte occupation, certes, mais une occupation qui n’avait pas eu lieu depuis celle de 1968, selon elleux), l’ouverture et la cohabitation dans un squat en banlieue parisienne et le développement d’un travail éditorial quotidien, sous la forme d’une publication de fortune regroupant leurs lectures et écrits respectifs sur des sujets politiques et artistiques. Cette publication hebdomadaire était leur manière de rapprocher l’art et la politique, d’en constituer un discours commun et de l'adresser à un public militant qu’iels fréquentaient à l’époque, afin de créer un liant entre des préoccupations qui se tournent souvent le dos.
À cette période, Julien était vendeur de livres à la sauvette. Il avait décortiqué les circuits de distribution de livres et il dealait directement avec les éditeurs pour en acquérir et les revendre à prix coûtant. Julien était un colporteur à la bourse vide. Il déposait toute sa marchandise dans des lieux de passage et d’attente, dans des gares, sur des bancs d’arrêts de bus dans les villes de Paris, Marseille, Limoges et bien d’autres. Sans un bruit, il vendait des livres et des revues qui diffusaient les idées politiques qu’il défendait. Il développait des contextes de diffusion de pensées, comme ses bibliothèques subjectives qu’il produisait selon les classifications de ses propres collections de livres. Maintenant, Julien est artiste / apiculteur / travailleur du sexe. Ses pratiques se construisent en miroir et deviennent une méthode de survie pour ne pas être affilié à une seule tâche (comme les abeilles, qui en auraient sept). Elles permettent une diversité de pensées, de production, d’économie. Olga, elle, est peintre / fondatrice et éditrice de la maison d’édition Hourra / conseillère municipale à la mairie de Lacelle. Olga peint des fleurs, des pâtissons, des outils. Elle peint une banalité quotidienne intemporelle, ancrée dans un temps, dans son temps. Sa pratique éditoriale lui permet d’avoir une position politique et d’assumer en pleine conscience un désir de faire de la peinture comme un pur geste pictural, dénuée de toute intention militante et, pour autant, intrinsèquement politique.
Mieux vaut pain en poche que plume au chapeau
De retour à Paris, les grèves s'enchaînent. On a peur pour nos retraites. Je me remémore comme un songe le récit de Julien et Olga et leur expérience de construction d’un dragon en tissu d’une vingtaine de mètres, un char humain animé par un système de fumée, que les membres de l’Amicale mille feux faisaient rôder régulièrement pour s’opposer à la construction d'une nouvelle usine sur le territoire corrézien. Après cette bataille victorieuse, le dragon (métaphore de l’usine) s’en est allé combattre dans une chorégraphie carnavalesque le célèbre triton de Notre-Dame-des-Landes pour une fête annuelle de la ZAD. Je repense aussi à The Bread and Puppet Theater10, une compagnie de théâtre radicale basée aux États-Unis, qui développe dans les années 1980 des spectacles de rue de marionnettes en papier mâché représentant les figures d’oppressions politiques de l’époque ou historiques, rejouant des saynètes dans le cadre de manifestations, de parades ou de reconstitutions. Le Bread and Puppet Theater s'implante notamment dans des quartiers populaires et propose des ateliers de production participative de marionnettes, générant des espaces de rencontres et de convivialité entre les habitant·es et des formes permettant de porter des luttes partagées. À cela s’ajoute l’anecdote, comme le nom de la compagnie l’indique, de la confection de pains distribués pendant les représentations, car selon l’un de ses cofondateurs, Peter Schumann, l'art « est aussi indispensable à l’humain que le pain ».
Ces formes de vie et de création communes produisent non seulement des nouveaux temps et espaces de rencontres, de productions, de paroles, de luttes et de refuges, mais elles constituent également l’archive vivante d’un tissu qui peut se déployer partout. À chaque territoire sa lutte et si la terre à défendre est déjà recouverte d’armes ou de béton qui étouffent ses habitant·es, alors c’est une entrée en résistance, une lutte pour une écologie sociale qui se met en place. En 2022, la documenta 15 à Kassel, en Allemagne, a mis à l’honneur ce déplacement des formes individuelles à des formes communautaires, porteuses de discours et où l’archive, la documentation, la mise en place de bibliothèques radicales11 ou la présence vivante seraient de nouvelles manières de s’approprier l’entité « art », comme un canal de diffusion de ces pratiques quotidiennes. Parfois pauvres, parfois débordantes de matières, de paroles en cours d’énonciation, de formes vernaculaires historiques, ces esthétiques nous éloignaient des critères esthétiques connus de nos regards et critiques eurocentré·es. Spectateur·ices apathiques de ces territoires et ces luttes inconnu·es, nous nous retrouvions ainsi bouche ouverte et l’esprit hébété à l’égard de ce que nous attendions d’une manifestation de « l’art contemporain ».
J’ai réalisé récemment que les écoles d’art – elles doivent survivre pour cela – ne sont pas uniquement des institutions qui œuvrent à “faire des artistes”, bien au contraire. Car les récits énoncés, ici et ailleurs, trouvent leurs sources au sein d’écoles d’art, dans une relation entre usager·ères de ces institutions (étudiant·es, enseignant·es, technicien·nes, etc.). Ces écoles sont habitées par des êtres sociaux qui développent collectivement des manières de penser le monde, leur monde, qui changent les paradigmes relationnels dans d’autres domaines professionnels. (Ce n’est pas un échec, c’est notre force : on s’immisce partout.) Combien de fois ai-je pleuré à chaudes larmes en me disant que ce monde de l’art dans lequel j’évolue ne sert à rien. Qu’il ne change rien au monde qui brûle, qui nous étouffe. Que nos existences artistiques n’ont pas d’effet immédiat sur les problématiques sociales, économiques, écologiques actuelles. L’art seul ne sert à rien, il n’a pas d’impact. Mais il peut être pensé comme un canal de transmission de pensées, de tentatives à notre échelle. C’est encore cette histoire de deuil, accepter ce qu’on perd : une reconnaissance directe, une économie idéale, mais presque inexistante pour la majorité d’entre nous. Et de comprendre ce qu’on trouve en échange. Alors, c’est ok de ne pas être artiste à plein temps en sortant d’une école d’art et de cumuler des jobs pour tenter de vivre quand même, en faisant un peu ce qu’on aime. Il y a nécessairement d’autres formes, d’autres postures (hormis celle d’un obsolète dandysme condescendant) qui permettent d’être ce qu’on nomme administrativement : artiste-auteur·ice. Nous cohabitons et nous créons avec cette entité abstraite qu’est « l’art » des réseaux d’êtres qui déploient des ressources de solidarités, des espaces de pensées communes, des points de chute. Une grande toile sur laquelle nous sommes toustes accroché·es et grâce à laquelle nous ne pouvons pas tomber. Récemment, j’ai réalisé que je n’avais plus peur de me perdre, que j’avais le sentiment que, dans chaque région de ce pays, j’avais une possible connexion avec une ou des personnes, liées encore ou non à l’art, mais des personnes qui pourraient m'accueillir, chez qui je pourrais dormir, manger, me réfugier, et cela m’a beaucoup rassurée.
Enclavée dans l’observation de mon propre quotidien et de ses injonctions paradoxales constantes, je ne me sens pas légitime à écrire ce texte sans vos récits, vous ne vous sentez pas légitimes à me parler de vos vies personnelles, qui pourtant sont le moteur d’énergies salvatrices, elles positionnent nos curseurs sur la balance de l'éthique. Nos pensées sont récits avant de devenir théorie, pour qu’ils entrent en résonance avec d’autres, ailleurs, pour se tisser et créer des liens solides. Pourtant, je me demande encore comment entrer en résonance avec vos récits, non vécus, comment mes mots peuvent trouver une justesse dans leurs transcriptions, biaisées par mon propre récit personnel et l’intérêt que je vous porte, sans raison explicable de prime abord. Entre ces lignes et les routes qui nous lient, il n’y a pas de vérité. Pas de réponse, seulement des tentatives de mises en récit, pour comprendre comment faire, autrement.
Rencontres réalisées entre mars et juin 2023.
Peuple et Culture Corrèze fait partie du réseau Peuple et Culture qui regroupe aujourd’hui quatorze associations. « Peuple et Culture Corrèze agit sur le territoire dans une grande fidélité à ses origines en gardant le caractère “généraliste” de l’éducation populaire : une éducation à la fois artistique et politique. » https://peupleetculture.fr/presentation/, consulté en juillet 2023.
À propos du groupe RADO, https://groupe-rado.jimdofree.com/, consulté en juillet 2023.
Jacent, Charlotte Houette, Malak Varichon El Zanaty, Marie Schachtel, Olivier Douard, Matthieu Palud, Louise Sartor, Sam_Liz (Sam Basu & Liz Murray), Mathis Collins, Kim Farkas, Léo Forest, Clio Sze To, Mona Varichon, Fabienne Audéoud, Christophe de Rohan Chabot, Naoki Sutter Shudo.
Presumption of friendship, terme employé par Sam et Maxime lors de nos rencontres en mai 2023.
Roland Barthes, Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quelques espaces quotidiens. Notes de cours et de séminaires au Collège de France (1976-1977), Paris, Seuil / Imec, 2002.
Kristin Ross, La forme-Commune, Paris, La fabrique éditions, 2023, p. 99.
Titre de l’exposition personnelle d’Olga Boudin, 30 rue du Docteur-Potain, Paris, 2023.
« En grève jusqu’à la retraite », affiche imprimée en risographie, 29,7 x 42 cm, Paris, éditions Burn-Août, mars 2023.
Françoise Kourilsky, Le Bread and Puppet Theatre, Lausanne, La Cité, collection Théâtre vivant, 1971.
Lou Ferrand, Bibliothèques radicales - Archives et reading rooms à la 15e édition de la documenta, Kassel, Jeunes Commissaires / Institut français, 2022, consulté en juillet 2023, https://www.jeunescommissaires.de/bibliotheques-radicales-archives-et-reading-rooms-a-la-15e-edition-de-la-documenta-kassel/











