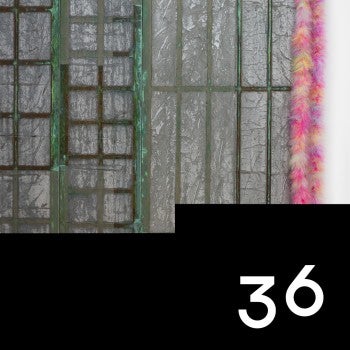1.
...ces figures de la déchéance acquièrent une dimension surnaturelle.
Malgré un intérêt prononcé pour les marges et les communautés qui les habitent, Jean-Charles Hue explore des thématiques si nombreuses qu’il est difficile de trouver un point de départ pour évoquer son œuvre. On pourrait en effet commencer par la question des marges, mais aussi des origines ou de leur quête, la rédemption (omniprésente) ou du moins le salut, la femme, l’homme, le rapport au monde animal, le crime, le criminel et le spirituel, le rituel, ou encore la frontière entre la vie et la mort, voire la frontière tout court. Tous ces thèmes, et bien d’autres encore, sont profondément ancrés dans la pratique de Hue. Il m’a rarement été donné de découvrir une œuvre abordant des enjeux aussi essentiels, évidents et urgents. Une œuvre habitée par le fanatisme évangélique d’un croyant, ou par une volonté désespérée de croire. Mais croire en quoi ? Cet article serait un bon prétexte pour examiner l’objet de cette croyance et son rôle dans le travail de Hue. Mais au préalable, et avant de traiter des nombreux thèmes mentionnés plus haut, mieux vaut peut-être commencer par exposer les faits.
Jean-Charles Hue, né en 1968, est un artiste et réalisateur français, actif dans les champs de l’art contemporain et du cinéma. Son travail a été montré en galerie, principalement à la galerie Michel Rein (Paris et Bruxelles), dans des institutions, notamment à l’occasion d’expositions au Frac Bretagne (2015) ou à la Fondation d’entreprise Ricard (2007), ainsi que dans des festivals de cinéma tels que Cannes et Turin. Ses longs-métrages ont reçu de nombreuses récompenses et distinctions, dont le prestigieux prix Jean-Vigo (pour Mange tes morts : Tu ne diras point, 2014), et ont été salués par les Cahiers du cinéma. Hue est probablement mieux connu pour son travail au sein des communautés yéniches et roms installées autour de Paris, avec lesquelles il a tissé des liens étroits. Il a vécu parmi elles, à la manière d’un journaliste gonzo, et en a fait les sujets de courts puis de longs-métrages réalisés entre 2005 et 2014. Plus récemment, son travail l’a emmené à Tijuana, ville mexicaine frontalière dont il est devenu un habitué, sillonnant ses rues et filmant ses habitants dans de nombreux courts-métrages, parmi lesquels Tijuana Jarretelle le Diable (2011), Agua Caliente (2013), Crystal Bullet (2015), Tijuana Tales (2017) et son plus récent (à l’heure d’écrire ce texte), Topo y Wera (2011-2018).
D’un point de vue formel, on a beaucoup commenté le style de Hue, mêlant fiction et documentaire, qui doit autant à la simplicité prosaïque de Jean Rouch qu’à la poésie des films-essais de Chris Marker. La dette est méthodologique, formelle et même spirituelle : difficile en effet, chez ces deux cinéastes, de distinguer la réalité de la fiction – en d’autres termes, on ignore où finit le réel et où commence la fable. Formelle, sa dette l’est à travers son style direct, caméra à l’épaule. La composante spirituelle réside quant à elle dans un désir presque compulsif de voyager (ce n’est pas une coïncidence s’il s’intéresse principalement à des « nomades ») ou du moins d’habiter l’espace liminaire de la frontière, synonyme d’une quête de la rédemption, mais tout en se distinguant de ces influences en ce que les voyages de Hue s’avèrent bien plus figuratifs et traitent de la figure du laissé-pour-compte : l’étranger, le marginal. En cela, il partage peut-être plus d’affinités avec Jean Genet ou Roberto Bolaño, non seulement vis-à-vis de leur attachement à la transgression et au non-conformisme, mais aussi pour leur célébration de la marginalité, qu’ils érigent au rang de mythe et de fétiche. Mais ce qui ne constitue qu’une facette de ces deux écrivains occupe une place centrale dans l’esprit et la trame des films de Hue. Cela ne signifie pas pour autant qu’il idéalise ou embellit la vie marginale, du moins au sens traditionnel du terme. Si idéalisation il y a, celle-ci renferme toujours une composante quasi religieuse : face à la caméra, ces figures de la déchéance acquièrent une dimension surnaturelle, vacillant à même l’image sur la frontière qui sépare les vivants des morts. En outre, il confère à ses sujets une dignité visionnaire et parfois déchirante, par son regard relativement indifférent et dépassionné et sa capacité à filmer ses sujets sans porter de jugement, qu’ils soient en train de manger, d’errer dans les rues, de fumer du crack, de créer leurs propres rituels ou d’être en proie à des visions.
2.
Bien qu’on le connaisse surtout pour son travail parmi les Yéniches, l’intérêt marqué porté par Hue à Tijuana au cours des dix dernières années, s’il ne marque pas un virage dans sa pratique, nous renseigne toutefois sur sa manière d’opérer. Géographiquement parlant, cette ville est à de nombreux égards un endroit parfait pour explorer les sujets les plus chers à l’artiste. Pourquoi et comment ? Commençons par Tijuana. Cette frontière singulière mérite qu’on s’y arrête avant de chercher à décrire la manière dont elle est abordée par Hue. Fondée en 1889, Tijuana a connu de nombreuses vies qui n’ont pratiquement jamais été recommandables. Destination touristique depuis toujours, Tijuana devint un haut lieu de débauche et de perdition à l’époque de la prohibition, l’alcool et les jeux de hasard y étant autorisés. La construction de l’Agua Caliente, complexe touristique comprenant hôtel, station thermale, parcours canin, aérodrome privé, terrain de golf et casino, transforma la ville en un endroit mythique, prisé des stars d’Hollywood et des gangsters. Cet âge d’or, pour ainsi dire, a pris fin en 1935 avec l’interdiction des jeux d’argent et des casinos décrétée par le président du Mexique Lázaro Cárdenas. Depuis, la ville n’a cessé de se développer avec plus ou moins de réussite, avec le tourisme comme importante source de revenus. Mais entre 2008 et 2011, son image de villégiature licencieuse fut écornée par un pic de criminalité causé par des guerres intestines entre trafiquants.
Tijuana a toutefois retrouvé la stabilité depuis. Désormais plus sûre, elle attire les investisseurs et la création artistique (bien que les films de Hue ne le montrent pas, Tijuana est connue pour la vitalité de sa scène artistique, musicale et cinématographique et pour sa cuisine, la meilleure du pays – tout ne va pas si mal). Toutefois, son coût de la vie incroyablement bas et la proximité des États-Unis continue d’attirer une faune interlope : avec des dollars américains, il est beaucoup plus facile d’entretenir une dépendance aux drogues à TJ (tel qu’on la surnomme) que de l’autre côté de la frontière. Impossible non plus de ne pas évoquer l’omniprésence presque mystérieuse de la frontière terrestre la plus fréquentée au monde. L’ombre lugubre et monolithique qu’elle projette se ressent partout dans la ville – sa présence physique, sociale et surtout psychologique est incontournable et obsédante. En effet, dire que la ville est hantée – par son propre passé, par son présent liminaire et flottant, par son avenir incertain – est un euphémisme. Tijuana est à de nombreux égards une fantasmagorie urbaine.
« L’orientalisme », dit-il, « est une promesse, une invitation au voyage. »
Toutes ces raisons font de Tijuana – cette frontière interlope, hantée et rongée par la criminalité – un terrain particulièrement fertile pour les intérêts de Hue. Les thèmes des fantômes et des enfers, par exemple, irriguent le cœur d’Agua Caliente, court-métrage de fiction réalisé en 2013. Le film relate l’histoire du complexe d’Agua Caliente et de l’une de ses figures mythiques, la Faraona, dont la mort fait l’objet d’une reconstitution symbolique. Le film s’ouvre sur une série de plans rapprochés quasi abstraits d’une piscine et ses abords (vraisemblablement Agua Caliente), tandis qu’en voix off une vieille femme née en 1946 se remémore le déclin du centre touristique, son délabrement progressif et l’influence de ces ruines mystérieuses sur l’imaginaire collectif. Après des réflexions sur la destruction quasi complète et la splendeur perdue du complexe, la femme se met à raconter l’histoire de la Faraona, une danseuse réputée pour sa beauté, exploitée par son compagnon anglais, joueur dépravé, qui vola et dilapida son trésor – un sac d’or et de pierres précieuses – pour satisfaire sa dépendance au jeu. La Faraona découvrit son méfait, et dans l’affrontement qui s’ensuivit, le couple avala du poison. Lui seul survécut. Selon la légende, le fantôme de la Faraona revient les soirs de pleine lune rechercher son trésor. Ce moment du récit est narré sur fond de plans rapprochés d’un intérieur de facture classique – un bungalow, résidence supposée de la Faraona et de son amant. Ce sont les seuls vestiges architecturaux significatifs d’Agua Caliente. Dans la seconde partie, une jeune et séduisante Mexicaine en robe blanche est allongée sur un divan, près d’un Mexicain, torse nu sous un veston blanc, en train de se servir un verre. Au son d’une ballade sentimentale, elle se met à marcher à quatre pattes devant la petite maison, attachée par une laisse en ruban que tient l’homme, debout sur le porche. Le film s’achève sur un plan aussi superbe que perturbant : une fine lame de couteau remue un amoncellement de pierres précieuses écarlates sur le ventre bronzé de la jeune femme.
Si le film semble traiter à première vue de mort et d’érotisme, il a en réalité plus à voir avec l’intérêt déclaré de Hue pour la notion d’ « orientalisme » – qui, non sans ironie, fait de Tijuana une métaphore « exotique ». Je ne fais pas nécessairement référence à Edward Said et sa déconstruction critique du fétichisme dégradant et colonialiste du Moyen-Orient, mais plutôt à l’approche presque naïve de Hue envers cette notion. « L’orientalisme », dit-il, « est une promesse, une invitation au voyage1. » Cette idée se rapproche davantage du fantasme, et même de l’hallucination et de la soif de découverte. Nous avons affaire à une Tijuana hallucinée qui, à l’image de la légende de la Faraona, est inextricablement liée à la réalité de cette ville.
3.
...elle lui raconte ses « visions » dans lesquelles le diable vient la prendre.
Dans la quasi-totalité des films de Hue tournés à Tijuana, une femme – ou la femme en général – se métamorphose en une figure transitoire à mi-chemin entre les mondes des vivants et des morts et fait office d’intermédiaire sacré – comme au sens de sacrificiel – entre ces deux univers. Elle incarne en effet le point d’articulation d’un équilibre complexe. Je pense évidemment à la Faraona, dont la fin semble annoncer – sinon accompagner – le déclin d’Agua Caliente, mais également au personnage de Pretty Eyes dans Tijuana Jarretelle le Diable (2011). Recourant aux mêmes procédés cinématographiques qu’Agua Caliente – une caméra errante, en transe, nous offre des plans rapprochés sensuels de détails (vêtements, corps, mobilier), tantôt nets, tantôt flous –, le film est narré par un homme en voix off. Dans une atmosphère teintée de réalisme magique, on suit la relation d’El Tuerto (« le Borgne »), que beaucoup soupçonnent être sinon le diable, du moins l’un de ses proches associés, et de l’étrange Pretty Eyes. Cette jolie femme, vêtue d’une robe blanche et semblant plongée dans un état de transe, est enceinte depuis deux ans de sept ou huit mois. On dit quelle porte l’enfant d’El Tuerto mais qu’elle ne le désire pas : la naissance de ce bébé – l’enfant du diable – entraînerait la fin du monde. Mais quand Yvon (un autre personnage), à la recherche de son frère disparu, donne à El Tuerto des vêtements extravagants, dont Pretty Eyes est friande, en échange de vidéos d’exécutions liées à la guerre des cartels, la naissance de l’enfant (autrement dit la fin du monde) devient imminente.
Dans Tijuana Tales (2017), Hue recourt aux méthodes qui ont fait sa réputation, mêlant fiction et documentaire au point de les confondre. Filmé en 16 mm, caméra à l’épaule, le court-métrage évoque une hybridation formelle entre les méditations quasi mystiques de João Maria Gusmão + Pedro Paiva, Sans soleil (1983) de Chris Marker et Les Maîtres fous (1955) de Jean Rouch, tout en conservant une identité qui lui est propre. Ici, le récit est centré sur la belle Roxana, prostituée accro au crack (dont on apprend que les enfants, qu’elle mentionne souvent, sont « loin d’ici ») et son bienfaiteur (et possible souteneur) Charlie, un chasseur de serpents qui offre à Roxana et d’autres « arpenteuses de bitume» des séances de massages dans sa camionnette, entre deux clients. On y croise également une cohorte bigarrée de personnages féminins évoquant des figures chamaniques dévastées. Certaines semblent flotter au-dessus du sol, et toutes semblent avoir sombré dans la folie ou basculé dans un monde parallèle – deux états qui se confondent dans l’univers de Hue, mais aussi et surtout dans les cultures indigènes filmées par Rouch. Chez Hue, en effet, aussi bien les hommes que les femmes semblent abandonner monde profane et quotidien par le biais de la drogue, de la communion avec le monde animal (Charlie et ses serpents), de la violence ou même du crime, pour entrer dans l’espace sacré du liminaire, celui de l’homo sacer2 – en l’occurrence celui de la ville de Tijuana. « Une malédiction pour ces femmes », lance Charlie à propos de la ville frontalière (décrite comme une « voleuse d’âmes » dans Tijuana Jarretelle le Diable). On croise une femme, vêtue de plusieurs couches de vêtements dont un string violet par dessus des collants en lycra, parée d’une longue traîne rouge évoquant une robe de mariée dont elle arrache et lance des morceaux dans la rue comme pour répandre des bénédictions. Il y a aussi Ana, allongée sur un lit couvert de détritus, qui est selon le narrateur la reine d’une autre planète située au nord de Tijuana. Puis vient Marlene, qui collectionne des verres de lunettes censés pouvoir redonner la vue à son œil borgne. Plus tard, l’artiste retrouve enfin Roxana, qui lui demande de l’argent pour se payer sa drogue. Il accepte et en profite pour lui acheter un peu de nourriture. Elle l’emmène dans une chambre, ils s’allongent sur le lit, et elle lui raconte ses « visions » dans lesquelles le diable vient la prendre. Elle réapparaît ensuite dans une autre chambre (probablement une autre vision), frottant une croix rouge peinte à la hâte sur le mur tandis qu’un gangster couvert de tatouages (le diable ?) la fixe du regard. Vers la fin du film, elle se tient assise, léthargique, dans la même chambre, à l’aube, tandis que des images floues de Tijuana – sa fantasmagorie – sont projetées sur les murs au-dessus d’elle.



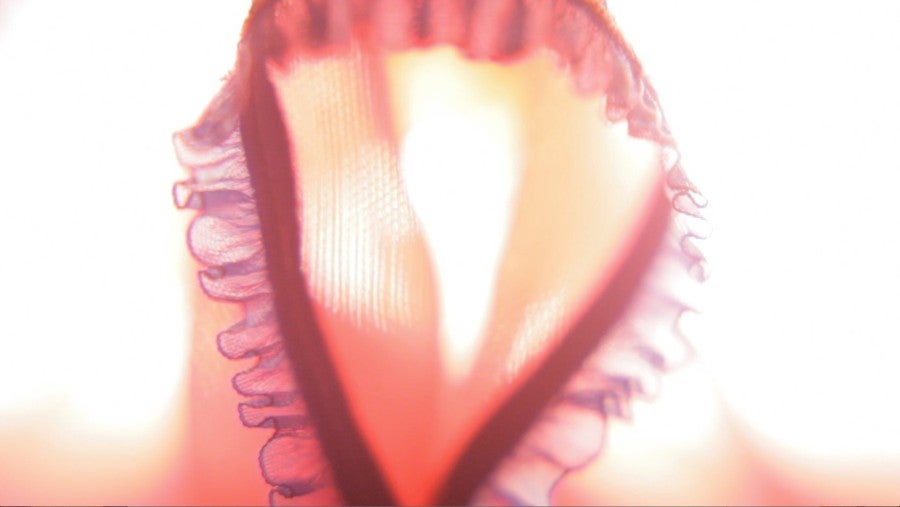
Si, dans ses films tournés à Tijuana, Hue privilégie sensiblement les portraits de femmes perdues – par opposition aux hommes –, c’est parce que les femmes représentent à ses yeux des symboles de la ville. « À Tijuana, dans la Zona Norte », dit-il, « les femmes exposent leurs corps à leurs clients potentiels. Depuis sa fondation par les Américains il y a plus d’un siècle, Tijuana elle aussi se prostitue. À l’époque, les femmes incarnaient une féminité éternelle et désirable qui permettait aux hommes d’oublier momentanément leur mortalité3. » La perte de la splendeur et de la beauté originelles de Tijuana (Hue rappelle volontiers que Rita Hayworth y fut découverte sur scène au début des années 1930) a entraîné le déclin de ses habitantes : si ces femmes sont devenues des fantômes, c’est parce que Tijuana n’est plus que l’ombre d’elle-même.
4.
Là où l’étrange beauté hallucinée de Tijuana Tales laisse une empreinte obsédante et onirique, l’histoire d’amour de Topo y Wera (2011-2018) propose une approche plus brute, complexe et documentaire de la ville. Ce moyen-métrage beaucoup plus tragique relate l’histoire de Topo, ancien dealer et sicario (assassin) tatoué de la tête aux pieds devenu toxicomane et voleur à la petite semaine, et de sa petite amie Wera. On suit les pérégrinations du couple à travers les bas-fonds de Tijuana. Ils se droguent, jouent aux machines à sous, volent sur les marchés, rendent visite à leurs amis – et parfois les dépouillent, à l’image de Martin, Américain irascible et édenté accumulant toutes sortes d’objets, convaincu (à juste titre) que son entourage le vole. On apprend que le couple s’est fait enlever son enfant Charlie (par un policier), que Topo a survécu à une blessure par balle à la tête dont la cicatrice est toujours visible, et qu’il a exécuté des violeurs d’enfants. La première partie du film atteint son point d’orgue quand Topo vole un short à Martin en présence de la caméra (pour ne pas mentionner l’éprouvante révélation de l’encéphalite testiculaire dont souffre ce dernier).
Si vous trouvez la première partie difficile à regarder, vous réaliserez bien vite qu’elle ressemble à un conte de fées à côté de la seconde. Sept ans ont passé. Topo n’est plus que l’ombre de lui-même. Il est seul, ayant perdu Wera, et vit dans les rues de Tijuana. La suite, un tour d’horizon de ses conditions de vie misérables, frise l’insoutenable. On le suit par dessus une clôture, à travers un dédale d’immeubles en ruine jonchés d’ordures en tout genre, et l’on découvre sa chambre de fortune, un taudis aménagé en dessous d’un escalier en béton qui ne mène nulle part. Le film s’achève avec des images muettes de Topo et Wera, encore ensemble, déambulant dans les rues de Tijuana. Topo semble relégué à la marge de la marge. À l’instar des nombreux habitants de Tijuana qui peuplent les films de Hue, c’est une âme perdue. Mais Hue ne manifeste pas forcément de la pitié ou de la tristesse à leur égard. Au contraire, je dirais même qu’il paraît les envier. Pourquoi ? Peut-être envie-t-il leur volonté ou leur capacité à s’abandonner à des états aussi extrêmes, à franchir si librement les seuils du monde des mortels pour plonger dans une sorte d’irréalité indissociable du monde réel, investissant et existant à travers ce dernier sous une forme quasiment hallucinatoire. Hue admet toutefois être animé par le désir de témoigner (de ce que la plupart des gens n’osent même pas regarder). « Autrefois, et parfois encore aujourd’hui, je croyais que mon travail possédait certaines qualités artistiques, mais plus le temps passe », écrit-il, « et plus je prends du recul, plus il me semble que le seul véritable intérêt de mon travail est d’avoir témoigné de choses qui ont disparu. C’est depuis toujours la fonction principale des images en mouvement, et c’est la raison pour laquelle j’en ai fait mon support, pour saisir, entre la lumière et les ténèbres, ce qui n’est déjà plus là4. » Non seulement Topo, Wera ou les innombrables fantômes de la ville, mais aussi Tijuana elle-même. À ce titre, Hue devient un témoin sur le seuil – un seuil physique, à la frontière de deux pays, un seuil spirituel, entre la vie et la mort, un seuil historique, face au futur de plus en plus incertain de Tijuana, mais aussi le seuil créé par la caméra, avec laquelle il filme, légèrement en retrait mais néanmoins au cœur de l’action. C’est précisément et paradoxalement ici, dans ce chaos anarchique, que son projet prend toute sa dimension et parvient à conjurer sa disparition.
Jean-Charles Hue, Y’a pas de prévenance !, Bussy-Saint-Martin, Les Forges de Vulcain, 2012, p. 140.
Dans la Rome antique, l’homo sacer était une personne exclue et par conséquent dépossédée de tout droit, qui pouvait être tuée par n’importe qui, mais qui ne pouvait pas faire l’objet de sacrifice religieux. Voir Giorgio Agamben, Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997.
Jean-Charles Hue, e-mail adressé à l’auteur, 2019.
Jean-Charles Hue, e-mail adressé à l’auteur, 2019.